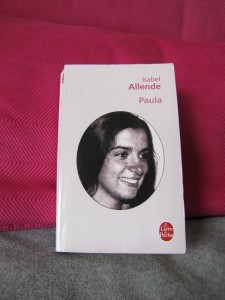Il y a des livres qui touchent notre âme, qui font vibrer les tripes et qui résonnent dans le cœur. Paula fait partie de ceux-là. C’est un livre terrible. Tellement terrible que je ne sais pas vraiment par où commencer à son sujet, tant je suis ensevelie par les émotions qui m’assaillent alors que je viens d’en lire les dernières lignes, les yeux embués de larmes.
Pourtant, je connaissais l’histoire, puisque je l’ai acheté de la même manière que ces livres. Je savais donc que ce livre est une lettre d’Isabel Allende à sa fille, Paula qui est dans le coma. Je connaissais aussi les sujets abordés, l’issue tragique du roman. Je savais, au fond de moi, qu’il me remuerait, en témoignent le nombre de fois incalculable où j’ai attrapé le bouquin dans la pile à lire, où j’ai regardé les 5 lettres du titre et où je l’ai reposé en me disant que ce n’était pas le bon moment. Je savais tout ça. Mais je ne me doutais pas qu’il me ferait autant vibrer. Pas à ce point là.
Vibrer parce que ce livre tout entier est un ode à la création littéraire. Le besoin d’écrire dans les moments d’émotions intenses, je le connais (la preuve), même si parfois on le garde pour sa sphère intime. Ce besoin de lâcher sa rage, sa colère, sa douleur, ses questions sur le papier (ou l’écran) pour s’apaiser, prendre de la distance, transmettre une émotion, chercher (trouver ?) une réponse ou laisser un souvenir transparaît tout au long des 450 pages du livre (p18-19).
L’écriture est une ample introspection, c’est un voyages dans les plus obscures anfractuosités de la conscience, une lente méditation. J’écris à tâtons dans le silence et, en chemin, découvre des parcelles de vérité, de menus cristaux qui tiennent au creux d’une main et justifient mon passage en ce monde. C’est un 8 janvier aussi que j’ai commence mon deuxième roman et, depuis, je n’ai pas osé changer cette date porte-bonheur. En partie par superstition, en partie par discipline, j’ai commencé tous mes livres un 8 janvier.
Il y a plusieurs mois que j’ai achevé Le Plan infini, mon dernier roman, et depuis j’attendais ce jour. Tout était prêt: le thème, le titre, la première phrase. Néanmoins, ce n’est pas encore cette fois que j’écrirai cette histoire. A présent, tu es malade, Paula, et je n’ai de forces que pour te tenir compagnie.
Et ces besoins, ils me parlent.
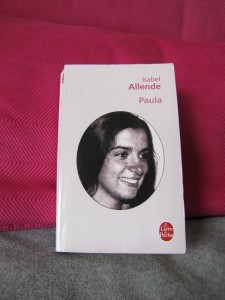 Vibrer parce que ce livre raconte non pas une histoire, mais deux. Il est d’ailleurs composé de deux parties, chacune écrite différemment, même si les sujets abordés sont les mêmes.
Vibrer parce que ce livre raconte non pas une histoire, mais deux. Il est d’ailleurs composé de deux parties, chacune écrite différemment, même si les sujets abordés sont les mêmes.
Dans la première partie, Isabel Allende écrit une lettre à sa fille, pour lui (re)transmettre son histoire familiale lorsqu’elle sortira du coma. On y découvre Isabel Allende petite, les personnages de sa famille, le Chili, le coup d’état, l’exil, le Venezuela, les mariages, les naissances, les divorces, les souffrances, les doutes, les morts, les illusions, la perte de l’innocence, la fuite, les jeux, bref tout ce qui fait la richesse d’une vie. Le récit de l’histoire familiale est parfois entrecoupé de « dialogues » entre l’auteur et sa fille, parfois de réflexions sur sa vie ou sur elle-même (p295).
Parfois, lorsque j’étais seule dans un lieu secret de la colline San Cristóbal, avec assez de temps pour penser, je revoyais l’eau noire des miroirs de mon enfance, où Satan apparaissait la nuit ; en me penchant dessus, je constatais, atterrée, que le mal avait mon propre visage, que je n’étais pas sans tâche, que personne ne l’était, qu’en chacun de nous il y avait un monstre tapi, que nous avions tous un côté noir et méchant. Dans certaines conditions pourrais-je moi aussi torturer et tuer ? Par exemple, si quelqu’un touchait à mes enfants… De quelle cruauté serais-je alors capable ? Les démons s’étaient échappés des miroirs et allaient librement de par le monde.
Dans la seconde partie, un virage s’amorce. L’auteur commence à entrevoir l’issue fatidique, à contre-cœur, à demi-mot (p275).
Je n’écris plus désormais pour que ma fille ne soit pas complètement perdue à son réveil, car elle ne se réveillera pas. Ces pages n’ont plus de destinataire. Paula ne pourra jamais les lire.
Non ! Pourquoi répéter ce que disent les autres si je ne les crois pas ? On l’a reléguée parmi les irrécupérables. Lésion cérébrale m’a-t-on dit…
Elle continue à parler de son histoire, mais s’adresse de plus en plus à sa fille à la troisième personne et non plus en utilisant le « tu ». La douleur est de plus en plus présente, les doutes aussi et l’espoir semble s’amenuiser peu à peu. La part qui évoque les soins prodigués à Paula, la veille de ses proches est de plus en plus importante. Jusqu’à la fin.
Ce livre raconte l’histoire d’une famille, mais il raconte surtout la douleur d’une mère qui voit son enfant partir, emporté par la maladie, par la mort. Quiconque a déjà accompagné un proche, malade, mourant, reconnaîtra cette douleur, ce déni, cette tristesse, ce sentiment d’injustice et d’impuissance, cette envie d’y croire malgré tout, cette tornade qui hurle au fond des boyaux et ne laisse aucun doute quant à l’issue, malgré les prières, malgré les sourires, malgré le « mieux » d’un examen parmi tant d’autres.
Ce livre, c’est une histoire d’amour, une histoire de vie qui cherche à comprendre l’incompréhensible, qui cherche une justification à l’injustifiable, qui cherche à sauver ce qui ne peut l’être, à calmer une fournaise que le moindre souffle, fut-il d’espoir ou de résignation, ravive, inlassablement, jour après jour, semaine après semaine, années après années.
Ce livre est réellement terrible, dans tous les sens que le terme peut avoir aujourd’hui. Terrible dans sa manière d’aborder une histoire, terrible dans sa manière d’aborder la vie, terrible dans sa manière d’aborder la mort, terrible dans sa manière d’aborder l’amour.
Un bâton de dynamite qui fait sauter tous les verrous et barricades pour dévoiler une vraie pépite .
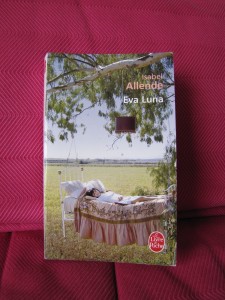 L’histoire se passe quelque part en Amérique du Sud, dans un pays qui ressemble à la fois au Chili et au Venezuela sans que l’on sache très bien où l’on se trouve. Le roman raconte, bien entendu, la vie, plus que rocambolesque, d’Eva Luna, depuis sa conception jusqu’à son dernier nouveau départ. Mais il raconte aussi la vie de Rolf Carlé, elle aussi assez mouvementée.
L’histoire se passe quelque part en Amérique du Sud, dans un pays qui ressemble à la fois au Chili et au Venezuela sans que l’on sache très bien où l’on se trouve. Le roman raconte, bien entendu, la vie, plus que rocambolesque, d’Eva Luna, depuis sa conception jusqu’à son dernier nouveau départ. Mais il raconte aussi la vie de Rolf Carlé, elle aussi assez mouvementée.